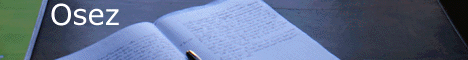par Guillaume Cingal
Ce récit brûlant qui se transforme en roman torrentiel, pluie diluvienne autant que lexicale, est ../dossierpdf/cingaldevi.pdfsur la figure féminine marginale, caractéristique des derniers romans d’Ananda Devi et si représentative de ce que Gilbert et Gubar nomment la folle du grenier (‘the madwoman in the attic’, la femme claustrée et contrainte au silence, version féministe de la "folle du logis"). Mais d’autres l’auront fait, sans doute.
Claustrée, Daya, que tous et toutes nomment "la Pagli" (la Folle), l’est assurément. Dans la première partie, elle ne parvient à nouer une histoire d’amour puissante, idyllique et métaphysique, avec Zil, le pêcheur, qu’en se sauvant de la demeure matrimoniale, "maison de sucre glace" ou, en créole, "gato lamarye". Dans la deuxième partie, une fois sa relation extra-conjugale et surtout hors-normes éventée, confiée aux rumeurs et aux "mofines" (les commères), elle se voit enfermée dans un poulailler d’où, provoquant rageusement un déluge de pluie, elle attend le retour de Zil. La première page de l’antépénultième chapitre se charge d’ajouter une pierre à l’édifice littéraire des femmes claustrées : "Je suis l’emmurée vivante. […] Je suis entombée, embourbée, incarcérée en moi-même." (p. 147)
En quoi, donc, la Pagli est-elle une affabulatrice ? C’est une narratrice dont l’idylle semble si magique, et surtout si abstraite, que le lecteur ne manque pas de trouver un deuxième sens au surnom, et au titre du roman : désireuse de s’inventer sa propre histoire en toute liberté, Daya/Pagli est une absolue fiction, car tout, dans ses propos et ses aventures, est fantasmatique. Jamais vraisemblable, quoique toujours saisissante, c’est une "figure", un "antipersonnage" au sens où l’entend Xavier Garnier dans son récent essai (L’Eclat de la figure. Berne : Peter Lang, 2001).
Le comble de la supercherie intervient au moment où Zil, le pêcheur, projection des fantasmes de la narratrice, et surtout de ses frustrations, prend la parole. Ou plutôt : lorsque Daya fait parler Zil, car, au regard d’une polyphonie bien factice, Zil parle comme Daya, d’une même voix, à l’unisson. Ainsi, Zil, dont le récit soulignait l’attachement à la réalité et le refus des propos métaphysiques chers à la Pagli (voir en particulier pp. 71-72), livre lui aussi des propos emphatiques et abstraits : "Sans le don que tu m’as fait de toi, je ne serais qu’un homme à peu près, un homme à demi qui ne sait pas ce que c’est que d’être homme." (p. 145).
En ce sens, à l’instar d’une silhouette dans un théâtre d’ombres, Zil est une pure projection d’un récit monologique, clos puisque voué la claustration. Zil, "île" promise, est l’appel du large, de l’extérieur, du Dehors, mais il n’est saisi par le texte qu’au mépris de sa particularité. Toutes les tentatives pour le "dire" (et même pour le faire parler) sont confinées au système intériorisé de la narratrice. Ananda Devi réalise ainsi une prouesse, en prenant à revers des décennies de production romanesque "phallogocentrique" et en faisant du sujet masculin un objet de discours, objet de passion certes mais principalement objet passif, silencieux. Si l’on suit les analyses d’Annie Anzieu, le phallogocentrisme consiste à "ramener tout système de compréhension au sexe masculin" (La femme sans qualité. Paris : Dunod, 1989, p. 74). A l’inverse, Devi fait émaner tout le système d’expression du sexe féminin : du sexe, c’est-à-dire de l’espace intime de Daya.
Annie Anzieu écrit plus loin dans son essai éclairant : "L’écriture féminine remplace pour la femme la gestation, ou la continue. Elle apparaît souvent comme le résultat d’une sublimation de la relation à un être aimé." (La femme sans qualité, p. 88) Comment mieux expliquer le discours ventriloque mis en place par Daya, mais aussi l’épigraphe de Pagli : "Tout roman est un acte d’amour" (p. 9).
Récit d’une affabulation tout autant que d’un affolement, Pagli se nourrit d’une irrationalité toute théâtrale. Symptomatiquement, d’ailleurs, au "Nous" collectif et anonyme des "autres", signal de l’exclusion bien-pensante (p. 130), s’oppose le Nous des amants, Je sublimé et porté en quelque sorte à la puissance deux, fausse extériorité : "Cette chose qui m’espace sous ma peau, qui la détend et la respire et y glisse de l’intérieur, c’est toi, Zil." (p. 79).
Pour dire l’intériorité blessée de sa narratrice, Ananda Devi n’a d’autre recours que de construire un roman expressionniste, dans lequel les couleurs, pour prendre un exemple marquant, témoignent d’une crise brutale de la représentation. Ainsi, lorsque Zil s’adresse à Daya pour raconter leur rencontre : "Tu étais enveloppée de gris. Tu contredisais les couleurs qui t’entouraient." (p. 143)
Les couleurs sont ce que la voix narrative en dit, sans symbolisme convenu et sans entre-deux. Le "noir véritable" est "un noir qui aveugle comme des larmes de sang et qui est l’annihilation de toute lumière" (p. 51). Même les adjectifs et substantifs usuels peinent à décrire les couleurs : "Le ciel est devenu couleur de violence. Cette teinte violette est rare et reconnaissable entre toutes." (p. 122) La violence n’a pas de couleur connue, et, en même temps, elle se voit assigner une place particulière dans le spectre coloré : le violet, qui allitère si bien avec elle. La teinte violette est d’ailleurs reprise en fin de roman pour décrire un ciel nocturne : "La nuit se dilate et strie le violet du ciel" (p. 150)
Affabulation expressionniste, Pagli est, tout autant qu’un roman ou qu’un acte d’amour, un cri, une longue imprécation, savant mélange de violence et de mélancolie. Plus réussi formellement que le roman précédent d’Ananda Devi (Moi, l’interdite. Paris : Dapper, 2000), il constitue une porte d’entrée privilégiée dans l’univers particulier de la jeune romancière mauricienne.
Guillaume Cingal
22-31 janvier 2002