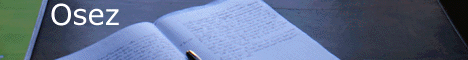par Guillaume Cingal
Paris : Seuil, 2002. 256 pp. 18 euros.
Henri Lopes, auteur de romans essentiels comme Le Chercheur d’Afriques (Seuil, 1990) ou (avant-dernier en date) Le Lys et le Flamboyant (Seuil, 1997), donne un peu l’impression de s’être fourvoyé dans une histoire trop simple… ou de s’être englué dans une thématique riche mais insuffisamment fouillée.
Il n’offre rien de bien nouveau, en effet, ce retour au " pays " (ici, une utopique mais bien africaine République du Mossika) du chercheur émigré dès sa plus tendre enfance et, du coup, " occidentalisé ". Même s’il prend la forme d’une enquête sur le père que Lazare Mayélé a très peu connu et qui fut autrefois victime d’un assassinat politique, le récit n’échappe pas aux conventions : le décalage entre métropolitains et " locaux " se double d’un constat amer relatif aux différences entre Afro-Américains et Africains. Il semble par ailleurs que d’autres ont transformé avec plus de bonheur l’essai de description des réalités politiques africaines, entre les non-dits des dictatures " néo-coloniales " et les dérapages du pluralisme balbutiant : on songe entre autres à L’Histoire du fou de Mongo Beti (Julliard, 1994).
Egalement, à l’heure où de nombreux intellectuels des " deux rives " réclament un débat sur ce que fut vraiment la colonisation, non pour porter des accusations mais pour établir les fondements de mémoires nationales responsables de part et d’autre, le narrateur donne un résumé quelque peu hâtif de l’enjeu : " Dois-je continuer de récriminer contre un ami sous prétexte que son grand-père a jadis giflé le mien ? Cet engouement irréfléchi pour le devoir de mémoire m’insupporte. " (p. 134) Cette incartade a pour inconvénient majeur d’aplatir le sens du " devoir de mémoire " et de ne pas vraiment entrer dans le débat. Heureusement, d’ailleurs, le personnage de M. Babela suffit à rendre compte, au rebours de telles affirmations, d’une mémoire historique du colonialisme à la fois complexe et articulée, même si Lopes souligne la part de fictionnalisation de tout travail mémoriel (p. 205).
Du coup, au sein d’une narration aussi ténue, la fabuleuse inventivité verbale de Lopes se dessèche : certes, Amérique et Europe sont peuplées de " Baroupéens " et " Mouroupéens "… le chauffeur de Lazare s’appelle " Mowudzar " (version déformée et métissée de Mozart)… Mais on se trouve à cent lieues des dédoublements de voix et des jeux de miroir baroques et savoureux du Lys et le Flamboyant, par exemple.
Il y a cependant quelques réussites indéniables. Ainsi, le père du narrateur, Bossuet Mayélé, reste dans l’ombre, jamais véritablement cerné. Dans sa quête du père, Lazare reste à peu près bloqué au point de départ, et sa véritable expérience de narrateur-sujet est ailleurs. En un sens, la fin du roman ne constitue guère une avancée par rapport au constat de Tonton Goma : " Pourquoi affirmait-il que je ne pourrais jamais comprendre la foi qui portait alors mon père ? Parce que le monde avait trop changé depuis lors ou bien parce que la personnalité de Bossuet Mayélé était trop complexe pour s’exprimer en quelques anecdotes ? " (p. 64)
En cela, le déterreur de fantômes (p. 17) reste (et laisse le lecteur) sur sa faim.
Le livre pose (et, une fois encore, c’est Tonton Goma qui parle) une autre question qui mérite l’attention des divers publics visés. Il s’agit de la réception des textes africains contemporains, qui est plus que jamais d’actualité (voir à ce propos le récent essai de Boniface Mongo-Mboussa. Désir d’Afrique. Paris : Gallimard, 2002) : " les Zoulous ne lisent pas, hormis la littérature sportive et les magazines de mode. Quant aux Baroupéens, l’Afrique ne les intéresse pas. " (p. 235)
Voilà qui n’est peut-être pas une exagération…
G.C.
12 mars 2002.