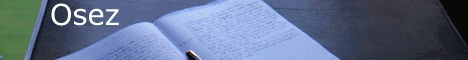Editions Stock - 2025
jeudi 20 mars 2025 par Alice GrangerPour imprimer
 Les éditions Stock ont proposé à Christine Angot d’écrire un livre pour leur nouvelle collection : « Nuit au musée ». La somme gagnée avec ce livre, calcule-t-elle, pourrait lui permettre d’acheter un appartement. Mais surtout, elle a envie de faire cette expérience. Pas pour passer une nuit dans un musée, car même chez elle, la nuit, elle a peur. Elle a envie parce que… la maison d’éditions est d’accord pour que sa fille Léonore l’accompagne. Mère et fille réunie dans la nuit du musée comme depuis la nuit des temps elles le sont ?
Les éditions Stock ont proposé à Christine Angot d’écrire un livre pour leur nouvelle collection : « Nuit au musée ». La somme gagnée avec ce livre, calcule-t-elle, pourrait lui permettre d’acheter un appartement. Mais surtout, elle a envie de faire cette expérience. Pas pour passer une nuit dans un musée, car même chez elle, la nuit, elle a peur. Elle a envie parce que… la maison d’éditions est d’accord pour que sa fille Léonore l’accompagne. Mère et fille réunie dans la nuit du musée comme depuis la nuit des temps elles le sont ?
Le musée qu’elle choisit est celui de la « Bourse du Commerce », à Paris, parce que « c’est de l’art contemporain », celui qui se fait « maintenant », parce « qu’on en parle », parce que le fait d’être exposées là cela fait monter la cote des œuvres, parce que « c’est la collection Pinault » et donc que cela garantit la « reconnaissance », c’est l’argent et la sociabilité qui en résulte, c’est la fascination qu’exerce cette classe sociale exerçant le pouvoir sur qui en est exclue (comme Christine Angot), c’est parce que Pinault c’est une famille (une « vraie », aux yeux d’Angot ?, mais qui est partie d’en bas, François Pinault lui-même ayant grandi dans une ferme), sa collection d’art vaut « un milliard et demi ». Retenir : c’est de l’art contemporain, dans ce musée. C’est là que l’artiste a des chances de se faire reconnaître, s’il peut y exposer son œuvre ! Voire la créer ?
On peut se demander pourquoi le livre qui témoigne de cette « Nuit au musée » de Christine Angot et de sa fille Léonore ne les montre effectivement en train de faire cette expérience que de la page 130 jusqu’à la page finale de l’œuvre, page 161. Et pourquoi, si Léonore – qui depuis petite avait l’idée de faire l’Ecole du Louvre – va voir les œuvres d’art contemporain, et juge que c’est « vraiment très beau », et elle est vraiment bien placée pour juger de la valeur d’une œuvre, c’est vrai, c’est la parole de reconnaissance par excellence, sortie de la bouche de la fille, Christine Angot, elle, ne va rien voir, reste devant sa machine à écrire. Puis elle éteint son ordinateur, à une heure un quart du matin, et elles quittent le musée. « Tout ça pour ça ». Mais « tout ça », c’est quoi ? L’œuvre d’art contemporain par excellence, que l’artiste Angot a réussi à créer, dans le musée d’art contemporain lui-même, celui où il restera pour toujours, celui où un artiste qui veut être reconnu doit être exposé ? C’est que là, cette « Nuit au musée », la mère et la fille sont allongées côte à côte sur leur lit de camp, comme elles n’avaient plus jamais l’occasion de l’être, elles avaient regardé un film, allongées au sol, main dans la main, « on avait la sensation d’être ailleurs en dehors de la vie plate et ordinaire ». Voilà l’œuvre d’art peignant la mère et la fille ensemble depuis la nuit des temps et pour l’éternité, laissée là, invisible mais visibilisée par le livre écrit par Christine Angot. Une vraie œuvre d’art contemporain, qui touche chacun, qui parle à chacun. Et pour cause ! Nous comprenons que Christine Angot n’a accepté « la commande » de la maison d’édition que pour ça.
Un tableau vibre au cœur de cette « Nuit au musée ». C’est celui de Fragonard, « Les Heureux Hasards de l’escarpolette ». Lorsque la maison d’éditions lui a fait sa proposition, d’une part elle a pensé à la sculpture de sainte Thérèse d’Avila par Le Bernin, dans l’église Santa Maria della Vittoria, à Rome. Un ange dirige une flèche vers elle, son corps est tout en torsion, elle est en extase. En la voyant, Christine Angot s’est identifiée à elle, elle s’était dit, cela existe « l’extase d’un autre monde ». Elle, c’est toujours ce qu’elle ressent, témoigne-t-elle, elle a « toujours cette impression d’amour fou, d’une révélation, de quelque chose d’incroyable, qui est largement au-dessus de moi », et lorsque son mari Claude lui avait dit qu’elle écrivait bien, « c’était incroyable », et alors ne compta plus que l’écriture, elle était dans cette vie-là, elle était une autre, « qui n’existait pas, mais qui m’intéressait tellement plus ». Elle imagine que cette nuit dans le musée, ce sera comme sainte Thérèse dans cette église, qui est en extase. Et puis, elle a donc pensé au tableau de Fragonard, parce qu’il avait eu sur elle un tel incroyable effet, trente ans plus tôt, en le découvrant à Londres, à la Wallace Collection, avec son mari Claude. Elle s’est, écrit-elle, « attachée à ce tableau comme à aucun autre ». « La balançoire qui monte dans le ciel, les jambes de la fille dans des bas blancs, qui se balancent dans le vide. Le garçon qui regarde. » L’histoire de ce tableau est celle d’une commande d’un homme de la cour faite au peintre : peindre sa maîtresse sur une escarpolette, un évêque la mettant en branle, et lui placé dans le tableau de façon à être à portée de voir les jambes de cette belle enfant, et mieux même que ces jambes. Donc, le portrait de sa maîtresse en petite fille. L’homme de cour ayant entendu que cette maîtresse désirait être, en regard de son pouvoir à lui de la faire entrer dans l’autre monde des élites, une petite fille qu’un père installerait en princesse en la balançant en l’air en l’élevant le plus haut possible. La petite fille s’envolant si haut étant donc le fantasme de cette maîtresse dans sa relation à l’homme de cour, à l’homme pas de son milieu mais qui a posé ses yeux sur elle, et, tel l’ange du tableau, a reconnu quelque chose qui est en aplomb dans l’inconscient collectif : c’est la femme qui est le sexe fort, parce que c’est elle qui donne la vie, et pour cela depuis la nuit des temps elle fascine fille et garçon. Et depuis la nuit des temps, le garçon d’abord reconnaît, tel l’ange du tableau, cette toute-puissance du féminin, et la fille dès son premier souffle s’envole dans les airs, poussée par l’évêque d’être ce sexe fort. Donc, dans le tableau, l’ange et l’évêque sont en phase, et mettent en « branle » la petite fille dans la maîtresse. Mais, depuis la nuit des temps, si c’est le sexe féminin qui est « indéniablement » le sexe fort puisqu’il a la puissance de donner la vie et pas le sexe masculin, alors l’homme vit une castration originaire (telle une maladie d’Alzheimer déjà là depuis la nuit des temps par cette humiliation en pleine tête parce qu’il ne transmettra jamais la vie), tandis qu’il doit s’incliner, la mère ne conçoit jamais qu’une fille, du point de vue de la toute-puissance, et le garçon ne peut prendre sa revanche qu’en étant celui qui reconnaît cette toute-puissance et la couronne, car sans cette reconnaissance, la fille-mère ne serait rien. Sans l’ange lui envoyant ses flèches de reconnaissance, elle n’existerait pas. Ni sans l’homme qui a la force toute-puissante de socialement l’élever dans les airs, de la mettre en branle. Alors, il y a l’homme de cour dans ce jeune homme auquel la petite fille montre ses jambes écartées, et plus même, son sexe féminin fort. Le tableau de Fragonard peint tout autour de la petite fille à la balançoire tout un écrin de branches d’arbres d’où s’élève la lumière qui évoque un sexe ouvert de femme, où une petite fille est « mise en branle » d’où cette lumière dans cet écrin. Par lequel la maîtresse est aussi la petite fille, et même lui transmet l’injonction à la répétition. Ce tableau de Fragonard, qui a fait un effet sur Christine Angot comparable à celui que lui avait fait la statue de Sainte-Thérèse par le Bernin où elle se pâme (dirait Jacques Lacan), où une petite fille ouvre ses jambes – à la convoitise - au regard d’un homme, cela interpelle, tandis que c’est à partir de son roman, « L’inceste », qu’elle a commencé à pouvoir vivre de l’écriture (même si jamais elle n’a pu gagner autant d’argent que ceux qu’elle a rencontrés à partir de là dans le monde de l’art, d’où ce sentiment de ne jamais être de leur monde).
Christine Angot fait résonner sa peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce vraiment par rapport à l’élite, telle celle de l’art et de l’argent, dans lequel elle est invitée à entrer par Sophie Calle, qui ne lui avait jamais répondu lorsqu’elle avait proposé sa candidature quand elle cherchait un écrivain pour un projet, mais parce qu’elle était passée à la télévision elle était devenue visible, et elle se rappela d’elle. Alors, pendant « quelques années, par son intermédiaire, j’ai côtoyé des peintres, des sculpteurs, des galéristes, Ce qu’on appelle » le monde de l’art ». Tandis que Sophie identifiait « quelqu’un » à l’instant, avait du flair, n’était pas timide pour approcher les beaux hommes, Christine Angot se sentait invisible, n’arrivait jamais à « être moi-même ». Pendant dix-huit ans, son mari Claude avait assuré la vie matérielle, et croyait à son écriture, dont elle ne pouvait pas vivre, même les dix années où elle publia. Puis, avec son livre « L’inceste », elle commence à pouvoir vivre de cette écriture, et on a l’impression que celle-ci est pour elle une mère qui la présente à l’entre-soi du monde de l’art, où l’introduit Sophie, et où, séparée de Claude elle vit différentes aventures amoureuses, avec un journaliste, avec un artiste, avec un banquier, écrivant à chaque fois ce qu’elle sent. Mais à ces dîners, ces vernissages, ces événements mondains, elle se sent toujours invisible, comme si sa mère l’écriture n’arrivait jamais à la faire reconnaître au sens où elle le voudrait. Reconnue pour ce qu’était l’écriture pour elle : c’est-à-dire « écrire les choses comme elles étaient, alors que pour la plupart des gens c’était leur image qui primait et celle de leur entourage », la littérature n’étant pas un monde à part pour eux, « séparé du monde réel, indépendant des règles sociales, à l’intérieur duquel on pouvait écrire les choses librement ».
Christine Angot, à propos de sa mère, évoque cette « génération de femmes qui admiraient les hommes ‘intelligents’ ».
Donc, d’abord ce livre « La nuit sur commande » raconte la vie à Paris où, depuis que Sophie l’a introduite dans le monde de l’art, elle est conviée à des dîners, un par exemple au centre Pompidou où apparaît François Pinault accompagné par Charlotte Rampling, ou Carole Bouquet, ou à un vernissage chez Maxim’s où Catherine Deneuve, Bernard Lavier attirent les regards, elle fait la connaissance de Catherine Millet et de son mari Jacques Henric, qui parlait de Guyotat, de Sollers, Bataille, Artaud, Robbe-Grillet, ils présentaient les questions du sexe sur un ton d’évidence faisant consensus, tandis qu’elle, elle faisait silence, qui était compris comme un assentiment. Alors qu’elle, elle éprouvait un sentiment d’infériorité, se sentant dans une position fausse.
Dans le milieu de l’édition, elle se rend compte que « la hiérarchie est marquée par un système d’échange entre la crédibilité des uns et l’aisance matérielle des autres, qui se deale en permanence ».
Sophie fête ses cinquante ans. Il y avait Isabelle Huppert. Christine Angot se dit qu’elle devait leur faire se poser des questions, car elle ne trouvait pas vraiment la note, elle n’était jamais à la recherche d’une amitié, elle trouvait normal de ne pas être intégrée, elle avait l’habitude de se sentir à côté.
Des soirées dont elle attendait quelque chose, qui étaient un privilège à ne pas laisser passer, car son espoir, c’était une rencontre, une amitié. Mais elle était là sans être là, et elle s’ennuyait. Des années seule, participant aux événements liés à l’art, au début pour avoir un pied dans Paris et des amis, puis elle n’a plus rien attendu, elle faisait partie du paysage.
Lors de l’expérience amoureuse avec un artiste, elle se sent coupée en deux, « d’un côté celui que j’aimais, de l’autre la littérature ». Auprès de Sophie, elle perd sa place, évincée par Mazarine Pingeot puis Florence Aubenas.
En lisant, on finit par se demander : tout ça, - cette introduction, à partir de l’œuvre « L’inceste », dans le monde de l’art et le monde de l’édition, où le fait de pouvoir vivre de l’écriture (mais de manière honteuse par rapport à ceux qui vivent là où l’argent donne le pouvoir et l’aisance d’un entre-soi) et de pouvoir vivre des aventures amoureuses alors qu’il y a eu la séparation d’avec Claude ne semble pourtant jamais être un but atteint – c’est pour qu’enfin lui advienne une proposition qui permettra à l’écriture de réussir à dire ce qu’elle voulait dire. Ce qu’une mère voulait dire à sa fille en étant elle aussi une fille, lui transmettant une vérité concernant la fille ? Ceci se disant entre ce que dit le livre tandis que se prépare « La Nuit sur commande » et ce qu’il dit de comment elle s’est passée ? Ainsi qu’avec le tableau de Fragonard, éclairé par la statue de sainte Thérèse par le Bernin, cette « Mère supérieure » qui avait créé de si nombreux couvents dans lesquels ses « filles » étaient soumises à la « clôture » ?
Christine Angot témoigne d’abord que la première expo qu’elle a vue à la Bourse s’appelait « Une seconde d’éternité » et s’ouvrait sur une installation de Philippe Parreno dans la grande salle de la Rotonde, où les fresques de la voûte datant du dix-neuvième siècle représentent les échanges commerciaux sous toutes ses formes entre les cinq parties du monde, de la circulation des marchandises à celle des esclaves. Toute la presse était présente, ainsi que des gens des affaires, de la banque. Ce lieu de pouvoir, avec ces expositions de la Bourse, a pris le relais des « institutions publiques et dont le prestige a peu à peu remplacé celui qu’on attribuait à l’époque aux commandes de l’Etat ».
Une émission littéraire, où c’est elle qui reçoit des auteurs. Elle fait semblant. Elle a honte d’être là, alors qu’écrire était quelque chose dont elle était fière. Faire la description d’un livre ne l’intéressait pas.
Un jour, Christine Angot demande à Léonore sa fille ce qu’à quatorze ans elle avait aimé dans la pièce de Claude Lévêque, à Beaubourg, Valstar Barbie ». Elle répond qu’elle n’en a pas fait une lecture sexualisée, qu’elle ne s’était pas dit que « c’était un adulte qui était dans le fantasme, lié à une certaine féminité bizarre, fantasmée, via une nostalgie de l’enfance ». Elle comprenait sans distance, même si elle voyait bien qu’il y avait un « ailleurs ». Puis, quand la presse a parlé de viol, c’est devenu trop réel, elle a eu l’impression d’avoir été prise en otage, qu’on l’a fait participer « à un fantasme qui était bien réel ». A l’enfant, il impose. Alors que, dit Léonore, l’art devrait être une zone de liberté pour tout le monde.
Alors, lorsqu’il est question de « La Nuit au musée », Christine Angot dit que « La Bourse du Commerce », c’est « là où on n’entre pas », c’est ça que le musée représente pour elle, la puissance, le lieu du pouvoir, « le leur », une forme d’attraction-répulsion. « Quand tu voies leurs expos, tu vois qu’il ne faut surtout pas que tu oublies que tu es dans un lieu radical, sans compromission… c’est mondial cette espèce de vision… le retour aux chapelles… ». Cette « Nuit au musée » est une commande. Et celle-ci la renvoie à son père, à son « ordre » de se soumettre à l’inceste.
Dans le livre, avant d’arriver à cette Nuit « sur commande », elle évoque ses nuits difficiles, ses insomnies. Elle n’écrivait pas encore, lorsque déjà chaque soir elle entourait de conditions préalables l’entrée dans cette nuit afin d’éloigner les risques d’insomnie. Alors, elle pensait encore qu’elle ferait un travail « normal »… lorsque le problème de ces nuits serait réglé. Mais à ses candidatures, seules des lettres de refus avaient répondu. Pendant les années de son mariage avec Claude, le niveau d’alerte avait chuté, puisqu’il était là, que tout était à peu près contenu, qu’il assurait matériellement. Après la séparation, elle ne put plus dormir, car à tout moment pouvait s’installer dans sa tête l’ordre, la commande. La nuit, elle la prépare dès la fin de l’après-midi, elle ne prend plus d’appel téléphonique après une certaine heure, elle évite de lire le soir, elle ne peut plus réfléchir, son esprit se bloque. Mais c’est avant de se coucher que lui vient l’idée précise d’un livre, et alors, l’horizon s’ouvrant « peut-être », elle s’endort tranquillement (et ainsi elle a trouvé le titre de ce livre, « La Nuit sur commande »). Elle évoque dans le livre les demandes urgentes et sans appel de son père, qui « pouvait entrer à tout moment, se mettre dans les draps », et elle prise de « panique d’animal chassé », et pas d’autre choix que de « se débarrasser » de la demande, de la « gérer », essayant de se « déshumaniser » elle-même.
C’est donc très précis. Ce livre dit ce qui est. Le lien entre la commande éditoriale de passer une nuit au musée et la commande sexuelle de son père, entre ses treize ans et ses seize ans, puis à vingt-cinq ans pendant deux mois. Pendant ces deux mois, elle n’avait pas eu le courage de se suicider, elle savait que l’inceste était un choix de mort. Elle n’avait pas été reconnue par son père. Puis l’avait été à treize ans, elle l’avait rencontré, et c’est donc à partir de la reconnaissance qu’a commencé l’inceste. Avec, après-coup, une sorte d’intégration tel un forcing dans une famille, telle qu’elle était vue dans les années soixante-dix par sa mère qui était de ces femmes admirant les hommes intelligents, et elle est devenu « Angot », ça a fait commencer la « commande ». Christine Angot dit que pour elle, le lien doit toujours être établi entre ce qui lui est arrivé et ce qu’elle écrit. Elle a vécu « la commande », la demande, l’autorité, la contrainte. Et le mot « Nuit » a fait surgir le mot « commande ». Mais, avant cette commande-là, n’y avait-il pas eu une originaire « commande » ? La « commande » d’un enfant, de la part d’une femme, l’homme finissant par dire oui ? Une femme, à quelle commande résonnant depuis la nuit des temps avait-elle obéi pour « demander » un enfant à son amant marié et ayant sa famille, qu’il ne voulait pas quitter. Une jeune fille devait-elle, pour avoir une « valeur » collective, devenir « mère », devait-elle rejoindre celle qui, depuis la nuit des temps, dans l’inconscient collectif telle la fixation la plus archaïque de cette humanité, fascine par son pouvoir de reproduire la vie et pas les hommes ? Et alors, par cette « demande » qui retentit depuis la nuit des temps, cette aspiration par la commande de « devenir mère », n’est-ce pas la fascination la plus archaïque qui revient brutalement, animalement, dans le passage à l’acte devant le sexe féminin, celui d’une petite fille ? Le sexe fantasmatiquement fort, qui fascine de manière archaïque, qui détruit le cerveau même dans l’homme le plus intelligent, le plus cultivé, fait de lui un animal sexuel brut ? On entend dans le livre de Christine Angot « ce qui est », cette « commande » qui revient tout droit de quelque chose d’infiniment archaïque, et qui avait fait que cette femme ayant cet amant si brillant, mais marié, se sentant sans doute rabaissée, déclassée, pas dans la bonne classe sociale, celle du pouvoir, celle d’une famille de biens-nés, mais elle étant la « noire », lui fit la « commande » d’un enfant, afin elle de devenir « mère », c’est-à-dire cet « objet » originaire d’une fascination qui était encore d’actualité, la famille normale privilégiée en étant la preuve. La jeune fille maîtresse de cet homme brillant, de la bonne classe sociale, marié, était-elle elle-même habitée par la « commande » archaïque irrépressible, folle, « d’être mère » car étant elle-même fascinée par la mère fantasmatiquement toute-puissante par son pouvoir de « faire » les enfants et paraissant l’être aux yeux des enfants vulnérables à l’âge d’or de l’enfance si le fantasme maternel règne ? Et alors, le garçon ne peut-il se concevoir, dès son premier souffle, en ayant son père pour initiateur, qu’en répondant à cette « commande » de la femme qu’il la fasse devenir mère, qu’il la couronne « mère », qu’il plonge tête la première dans le gouffre de la fascination là depuis la nuit des temps, en effet « la Nuit sur commande » ? La Nuit est-donc cette fascination toute-puissante, qui « commande ? Sinon, n’existent ni la femme ni l’homme ? Mais si elle commande toujours, ni l’être humain femme, ni l’être humain homme ne peuvent exister vraiment, si tout est réduit, fatalement, à l’identité sexuelle, où le sexe féminin est le sexe tout-puissant, le mystère de la vie, l’origine de la vie, mais où le sexe masculin devient le plus fort par le passage à l’acte de la fascination reconnue qui est aussi du point de vue de la fixation la plus archaïque la reconnaissance elle-même de « ce qui est » : le pouvoir du sexe féminin de donner la vie. Alors, donner la vie autrement, en accueillant sur terre par la transmission, les leçons de vie, la formation des regards neufs à la complexité de la vie sur terre qui a une histoire très longue, tout cela ne vaudrait rien, qui pourtant reconnait des dons nourriciers aux hommes, aux humains indépendamment de leur sexe, par l’humus de leurs expériences à transmettre.
La date de cette « Nuit sur commande » est fixée au 12 juillet. La fille, Léonore, arrive de Montpellier la ville de son enfance, où elle est retournée après avoir obtenu son diplôme de la Villa Arson. Elle vit près de son père et de sa grand-mère, loin des vernissages, des galeries. Et elle aussi, comme sa mère, comme par hasard, a « peur de ne pas gagner sa vie. De ne pas y arriver. D’être seule. C’était elle, maintenant, le hasard, l’inquiétude. Les questions étaient de son côté. Vivre de son art. Rencontrer quelqu’un. » Rencontrer qui ? Remettre sur le métier « la rencontre » de la mère de Christine Angot ? Celle-ci dit à sa fille que lorsqu’elle lui « DEMANDE » de l’accompagner quelque part, comme cette nuit-là dans le musée, elle a peur « de la RETARDER dans sa propre vie ». Elle remercie sa fille d’être là, parce qu’ainsi, elle l’aide à la « rendre un peu plus légitime ». Léonore lui répond que « Moi non plus, maman, je ne suis pas légitime ». Mais légitime, ça veut dire quoi ? Le couronnement de celle qui, depuis la nuit des temps est « condamnée » à se fantasmer toute-puissante à cause de son corps différent, et sinon une femme n’est pas légitime ? L’être poétique, l’être artiste, est légitime de lui-même, librement, c‘est-à-dire jamais aliéné par son identité sexuelle. Et alors, que veut dire vivre de son art, vivre de son écriture - art et écriture prenant le sens de l’art de la transmission - si chaque être humain libre est poète, est artiste, aucun des humain ne restant en souffrance par rapport à cet élitisme d’un monde endogamique de l’art ? Toute son enfance, Léonore a grandi dans un appartement qui était le lieu de travail de sa mère, c’est-à-dire le lieu de l’écriture. Et la petite fille disait que ce qu’elle ne ferait sûrement pas plus tard, c’est devenir écrivain. Elle a expliqué que dire toute sa vie « j’en ai marre j’en ai marre » comme elle l’a entendu de la bouche de cette mère toute l’enfance, non, elle, elle avait autre chose à faire dans la vie.
Voilà. Elles sont toutes les deux dans le musée. « Dans notre espace, il y avait tout ». C’est-à-dire un bureau, des feuilles blanches, des stylos, deux catalogues de l’exposition en cours, un talkie-walkie, deux lits de camps. Le but de cette nuit devait être les œuvres exposées. Mais Christine Angot y est totalement indifférente. Elle ne s’intéresse qu’à écrire, elle n’avait rien réussi d’autre, elle n’avait jamais pu vraiment essayer de comprendre autre chose. « Ce qu’il y a, c’est Léonore », sa fille, c’est mère-fille. Elle n’est là que pour « être allongée à côté d’elle sur un lit de camp ». Elle trompe les gens, comme lorsqu’elle faisait semblant de relire ses cours, alors qu’elle corrigeait son manuscrit. Elles étaient « toutes les deux, seules dans l’espace… au milieu de Paris dans un lieu fermé à clef, où on avait eu l’autorisation d’entrer, qui contenait des œuvres exceptionnelles ». Léonore prend une photo d’elles-deux, dans le miroir de l’ascenseur, « je suis de dos, je la serre contre moi ». Le livre offre un témoignage écrit par Léonore, à propos de sa mère, du lien fille-mère. « Je voudrais être à partir du cœur. Si possible, tout le temps… Mais trop souvent, l’angoisse et la tristesse font que je n’y suis pas. Je pense à ma mère. Que j’aime. Mais quand elle crie, je voudrais qu’elle aille bien, et elle voudrait que j’aille bien aussi. Je voudrais qu’elle n’ait jamais mal. Je voudrais toujours être allongée près d’elle. Mais je ne peux pas. Je suis trop grande. Je pourrais, je voudrais, je pourrais vraiment toute ma vie rester allongée sur le canapé contre elle. Je serais contre elle, blottie. Je pourrais vivre ma vie là. Je lui donnerais ma chaleur… Comme une transfusion… que ça puisse être un état. » Une fille mère de sa mère. Une fille conçue être humain libre, poète et artiste, vivant d’elle-même ? Mais celle-ci peut-elle exister vraiment, si elle n’est jamais, enfin, nourrie par autre chose que tout ce qui se réduit à une métaphore de matrice biologique qui « commande » encore tout. Nourrie par la transmission, par l’humus très riches de leçons de vie, d’expériences, de formation à la complexité d’une aventure humaine si longue déjà et ayant laissé tant de traces transmises aux générations renouvelant l’aventure humaine sans cesse, humus que chaque humain possède et peut transmettre à l’autre pour l’accueillir comme soi-même, et humus d’ascendants à descendants depuis la « nuit » des temps mais étant absolument autre chose que métaphore de la matrice biologique, que la fixation la plus archaïque de l’humanité. La fille qui serait vraiment la mère de cette fille Christine Angot qui crie tout le temps, ce serait celle qui serait accueillie sur la planète de partage par cette transmission de paroles nourricières, par ces présences fraternelles l’accueillant en la regardant de manière humaniste comme un être humain ayant une importance collective, non pas une personne qui éternellement se sent de pas en avoir, d’être en souffrance pas dans le bon milieu, de ne pas être légitime.
Ce qu’a réussi Christine Angot, par « La Nuit sur commande » c’est laisser enfin dans ce musée, celui de la Bourse, son œuvre d’art à elle, qui dit ce qui est, ce qu’elle vit, c’est-à-dire ce qui est encore, ce qui « commande » encore, la fixation la plus archaïque pas encore détruite. Et c’est son livre qui rend visible cette œuvre d’art invisible. Œuvre d’art qui atteint l’universel parce qu’elle parle à chaque humain, qui, s’il veut vivre vraiment en poète et artiste, doit réussir à se séparer, à se sentir légitime de lui-même. Le mot « légitime » fait entendre la loi, celle qui dit, comme le rappelle Amos Oz dans « Chers fanatiques », de ne pas infliger la souffrance à l’humain, mais de l’accueillir sur la terre de partage, lorsqu’il arrive en renouvelant l’aventure humaine, chaque vie étant chaque matin renaissante, par les leçons de vie et témoignages de Prédécesseurs-compagnons-passeurs, et ayant donc ainsi pour première leçon celle qui dit à la nouvelle vie qu’elle a une importance collective. Chaque vie sans exception. Non réduite à son identité sexuelle.
Alice Granger
Livres du même auteur
et autres lectures...
Copyright e-litterature.net
toute reproduction ne peut se faire sans l'autorisation de l'auteur de la Note ET lien avec Exigence: Littérature