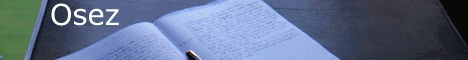Revue Le Grand Continent - 7 avril 2025
vendredi 11 avril 2025 par Alice GrangerPour imprimer
Le titre de ce très brillant essai de Dominique de Villepin, qui dessine la refondation d’une « République des vivants », vibre avec son discours de l’ONU en 2003 disant le « Non » de la France à la guerre en Irak décidée par les États-Unis, un Non qui fit résonner la fidélité gaullienne à une indépendance de la France et à la fondation humaniste de sa civilisation. Il fait résonner aussi, en parlant de l’épuisement de la Terre et de ses ressources, le discours de Jacques Chirac au Sommet de la Terre, à Johannesburg, en 2002, disant que « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre », disant lui aussi « Non » il ne restera pas complice de cette absence de sursaut face au désastre d’une planète en train de perdre sa qualité hospitalière à la vie et aux infinies formes du vivant, tandis que l’humanité, elle, regarde ailleurs. Cet essai nous montre ces nouvelles formes impériales qui regardent encore ailleurs.
Le titre résonne aussi, dans ma lecture de femme, avec ce « Non » des femmes que les hommes doivent entendre (et peut-être que leur Non doit encore remonter plus loin vers les fixations humaines les plus archaïques). Dominique de Villepin fait retentir le Non à l’épuisement par les humains de la planète Terre d’emblée, et le réitère en conclusion en disant que « la rareté planétaire est la source souterraine de toutes les dérives politiques actuelles », que nous « devons sortir de l’illusion d’un monde sans bornes, d’une humanité toute-puissante », inscrire dans notre droit, notre politique, notre économie, « le principe de finitude », que nous « devons mettre fin à l’exploitation aveugle des ressources ». Cette question de l’épuisement, du pillage et du déséquilibrage de la planète suggère, dans cet essai, que l’humanité a fait de la Terre une métaphore de matrice biologique dont le placenta est épuisé car arrivé en fin de gestation, l’humain retenu en gestation éternelle étant le prédateur par excellence « forant » ses ressources naturelles en les croyant inépuisables, sans limites, et lui-même étant tout-puissant pour se servir, tel le premier motif fractal du prédateur, du colonisateur. La Terre qui se révolte par ses catastrophes climatiques, dans une sorte de procédure d’apoptose enclenchée lui faisant perdre sa qualité hospitalière à une humanité encore en gestation, est en train de dire « Non » à cette grossesse éternelle, telle une mère qui veut vivre et qui, comme Gargamelle veut donner son fils Gargantua à la lumière du dehors par l’oreille en lui faisant entendre cet épuisement et que dehors les humains sont en train de préparer ensemble « la République des vivants ». La Terre elle-même, par ces signes irréfutables d’épuisement, dit aux humains que leur gestation est arrivée à son terme et que vouloir rester « dedans » est suicidaire, d’où cette bascule d’époque dont parle Dominique de Villepin. Alors, ce « pouvoir de dire Non » ne résonne-t-il pas en effet avec celui des femmes, arrivé à remonter jusqu’à une fixation très archaïque de l’humanité (et Octavio Paz dans « Le labyrinthe de la solitude » parle d’une humanité bloquée au stade adolescent, et alors ces formes impériales n’apparaissent-elles pas comme de gros oiseaux qui ont peur de s’envoler du nid ?) ? La planète épuisée disant Non pour mettre fin à la gestation métaphorique de l’humanité, parce que cela devient suicidaire de prétendre être mère éternellement, dans cet essai semble être écoutée par Dominique de Villepin dans son désir de donner à la lumière les humains par l’oreille. L’amour de cette Terre qui ne veut plus garder dans son ventre les humains est de l’amour scotiste qui donne ce qu’il n’a pas, qui donne à la lumière (en italien « dare alla luce), et au dehors terrestre habité où les « prédécesseurs-compagnons-passeurs » que sont les Français et les Européens (qui sont des têtes de proue car ils ont déjà par leur histoire l’expérience du sursaut vital hors d’une logique de guerre et de conquête qui avait si longtemps secoué le continent) viennent accueillir par leurs leçons nourricières de vie. La Terre, telle la femme qui jusque-là se fantasmait mère à vie, se fait rose de personne, et, comme l’écrit si poétiquement Dominique de Villepin, apparaît cette « lumière silencieuse qui fait de chaque vie une œuvre d’art » ?
Je voudrais donc faire résonner, en suivant pas à pas les leçons que nous offre ce brillant essai, cet appel au sursaut vital de l’humanité afin qu’ensemble, par une prodigieuse gerbe d’énergie et de lumière, et le désir de vivre en s’envolant parce que les plumes auront pu pousser sur les ailes, les humains fendent le mur des ténèbres menaçant qui s’approche de plus en plus.
Dominique de Villepin nous le dit, ce que l’humanité vit n’est pas une simple crise. C’est une mutation historique, une accélération prodigieuse de l’Histoire, avec impossibilité de descendre du train devenu fou depuis 1979 et l’irruption de l’islamisme radical, et ainsi de suite jusqu’au trumpisme d’aujourd’hui. Celui-ci, dit-il, est un symptôme qui, en attirant sur lui tous les regards, détourne des « maux essentiels » l’humanité afin qu’elle regarde encore ailleurs. Alors que l’épuisement est là, que les humains devraient s’unir dans le même sursaut de résistance et se donner méthodiquement les moyens de dire « Non », l’idée de progrès, les promesses de la modernité, l’ordre international issu des révolutions démocratiques s’effritant. Ce que les regards doivent voir, c’est plutôt que l’illimité prométhéen est fini, que le monde est en réalité fini, qu’il s’agit de partager, de cohabiter, et non plus dominer. Dominique de Villepin, en conduisant au choc frontal avec la fin de l’ère prométhéenne, veut entraîner avec lui la France et l’Europe dans un sursaut uni pour « retrouver le courage d’inventer une République des vivants ».
Alors que des formes impériales réactionnaires, face à cette raréfaction des ressources de la planète à cause de « l’exploitation intensive des ressources naturelles », de « l’intensification… des échanges mondiaux… l’expansion de la sphère marchande dans nos vies », de la « centralité de la puissance militaire pour garantir l’ordre », de « l’illusion de rivaliser avec les dieux », veulent que ce qui reste se partage, selon un rapport de force, entre les plus forts, pour que rien ne change d’une planète s’offrant à la prédation, comme dans la croyance que eux pourront avoir le privilège élitiste refermé sur son entre-soi de milliardaires de rester dans le ventre riche de ressources naturelles et métaux rares d’une Terre métaphore de matrice biologique. Rêvant même d’aller coloniser les étoiles comme une extension du Far West. Dans « l’effacement du commun », en en excluant l’accès aux populations auxquelles la démocratie libérale avait promis une planète de partage. Une concurrence des survivants égoïstes s’installe en croyant encore aux vieux dieux du progrès et dans une logique de conquête de ce qui reste, au prix de l’irréversible, avec le resurgissement des formes impériales, la compétition revenant en force, féroce, tandis que la rareté du monde et l’étroitesse de notre planète commandent à ceux qui veulent rester des prédateurs d’une Terre métaphore d’une matrice biologique d’exclure comme n’ayant aucune importance collective les populations qui, dans ce ventre de la Terre, sont de trop. Parce que ces empires réactionnaires savent très bien que le « ventre de la Terre n’est pas un puits sans fond » pouvant nourrir « dix milliards d’humains dans un monde qui dévore ses fondations ». Alors, s’épuise aussi le modèle de la mondialisation qui avait promis à tant de personnes sur la planète qu’elles sortiraient de la pauvreté, la promesse de prospérité se changeant en fracture planétaire, les profits allant dans les mains d’une élite planétaire et des métropoles. D’où un ressentiment qui enfle. Les protectionnismes, le commerce mondial devenant le théâtre des rivalités, des taxes punitives, tout cela tisse une nouvelle ère du « chacun pour soi ». Un monde sans horizon commun, avec une poignée d’acteurs économiques qui se partage les richesses, façonne les règles du commerce mondial. Dans les regards des populations qui ne comptent plus, l’épuisement se lit aussi, elles ne peuvent plus croire à un monde où les déséquilibres entre les pays pouvaient se rééquilibrer, qu’il y avait un pacte pour que le progrès profite à tous, la puissance militaire elle-même défendant le droit international, les États-Unis après l’effondrement de l’URSS exerçant la domination militaire, soutenus par leurs alliés. Faute de vision à long terme, de patience, de solution politique, de travail diplomatique, chacune des guerres, depuis la guerre du Golfe en 1991 (et en Afghanistan, Irak, Libye, Sahel) a piégé les puissances dans un engrenage infernal, dans une logique d’escalade, en humiliant les populations, en laissant les frustrations, les ressentiments, le désordre, le terrorisme.
Sur la planète, tout est à vendre, plus rien n’est sans prix. La complexité est croissante, la bureaucratisation et les normes qui se superposent, tout cela asphyxie l’humain « sous le poids de l’explicite normatif ». Dans ce monde qui s’épuise, ces humains sont en quête de protection, au risque de perdre la liberté, la responsabilité, la capacité de donner du sens à leur vie. La « dataïsation » du monde, au lieu d’ouvrir l’ère nouvelle de la communication et de l’émancipation, a pour conséquence que les humains sont sous techno-surveillance, les algorithmes les analysent, créant un nouveau féodalisme, les pensées étant devancées. Le monde se chiffre, l’humanité se calcule, le vivant est en train de se dissoudre. Dominique de Villepin peint une civilisation qui s’interroge, tandis que Prométhée est épuisé. Comme également la promesse de la modernité, « celle d’un monde libéré par la raison, élevé par la science, guidé par le progrès ». L’IA n’est pas une libération. La technologie ne dessine pas une émancipation partagée mais une « rareté organisée, une science cloisonnée, réservée à ceux qui peuvent se l’acheter ». S’annonce « l’inscription de l’inégalité sociale au cœur de la vie humaine ». L’espace aussi est le terrain de luttes, de convoitises, de prédations, la colonisation partant à la conquête des étoiles, après avoir pillé et souillé la Terre. L’identité elle-même, où chacun pouvait rêver pouvoir se réinventer, devenir autre, soi, être notre liberté la plus inaliénable, est prise d’assaut, devient territoire occupé par la droite ou par la gauche, enfermant dans des cases. Bref, l’humanité entre dans une zone de turbulence, écrit Dominique de Villepin. La fracture démographique mondiale « redessine en profondeur les rapports de force entre les continents, entre les générations, entre les récits ». Le monde du Nord (Europe, Japon, Chine) vieillissant, où la part des actifs chute, regarde le monde du Sud ((Afrique subsaharienne, Moyen-Orient) où la population est très jeune mais n’a pas d’horizon, et est fasciné par sa vitalité, et vice-versa, ce Sud est fasciné par la longévité des sociétés du Nord. Mais cela n’aboutit jamais à un projet commun. Asymétrie démographique qui dessine un « soulèvement silencieux du monde », parce que les « désirs de mobilité rencontrent des murs et des refus », d’où un choc politique qui contribue au populisme, au fantasme de submersion. Dominique de Villepin fait entendre l’urgence d’une solidarité à la bonne échelle, d’un « pacte intergénérationnel et intercontinental, car le monde ne pourra jamais devenir viable si les générations sont dressées les unes contre les autres, si sur la planète, il y a d’un côté les rassasiés et de l’autre des affamés d’avenir. Du côté de la nouvelle équation impériale, écrit-il, il y a donc les épuisements du monde, et de l’autre la réorganisation du monde autour de nouveaux empires qui se font à cause de la « peur panique de la pénurie », de l’angoisse du déclin, et mettent en branle des forces brutes.
Ce brillant essai nous peint un nouvel âge impérial qui, pour sauver une souveraineté perdue, s’attaque à la démocratie libérale par des réponses idéologiques. D’une part, celle de Donald Trump est un déni frontal, où « L’action prime, le verbe tranche, le chef domine », et « tout doit se soumettre au théâtre de la puissance, à sa visibilité, à sa démonstration », convoquant le « cowboy solitaire, le gangster impitoyable, le flic sans scrupule », des figures enracinées dans la mythologie américaine. Le trumpisme est, écrit Dominique de Villepin, « une structure affective, une économie morale fondée sur la domination ». Il « ne suit aucun projet, mais épouse chaque opportunité », il avance avec la certitude que sa force l’aidera. Son rapport au monde est utilitaire, par exemple les « matières premières doivent nourrir la prospérité nationale », et le « commerce international doit être un instrument de captation mondiale, un privilège sans contrepartie ». L’économie mondiale est siphonnée au seul profit du peuple américain et de Trump. Le commerce mondial devient un champ de bataille « aux allures de guerre commerciale permanente ». La technologie est son bras armé, l’IA et le quantique étant des armes. La collecte des données permet de surveiller, et de partir à la conquête des esprits. La réponse idéologique de Xi Jinping, héritée du maoïsme, ne nie pas les limites mais les intériorise, dans une logique de l’autosuffisance. C’est un empire qui se referme comme une forteresse technologique, industrielle, morale. Le Parti tient l’Etat, l’Etat tient la société, et celle-ci construit son indépendance. Pékin « renforce son autarcie industrielle, sécurise ses approvisionnements critiques…, restructure ses débouchés commerciaux vers l‘Asie, l’Afrique ou l’Amérique latine », la Chine fait des bonds technologiques spectaculaires par des investissements massifs, elle monte en puissance de l’intérieur, son arme est son marché intérieur, elle « devient un monde en soi ». L’envers est que c’est une logique fondée sur la méfiance, la surveillance, le contrôle, à l’intérieur et à l’extérieur. La Chine a choisi le contrôle alors que les États-Unis ont choisi la prédation. Face à Trump et à Xi Jinping, l’Europe est « l’empire bénin du droit et de la politique », écrit Dominique de Villepin. La logique est celle du compromis ou du consensus. Et, dit-il, nous « redécouvrons que l’Europe est un modèle d’actualité… peut-être le meilleur contre-modèle au néo-impérialisme qui agite le monde ». Mais, ajoute-il, le temps est venu « d’inventer les contours d’un ‘post-Empire’ ». Il évoque le Saint Empire Romain Germanique, qui a été l’empire le plus durable sur le continent, un millénaire. C’était un empire électif, « mosaïque d’entités de tailles diverses et presque souveraines, vaste espace de délibération, de jurisprudence, de droit et de respect des libertés ». Ne serait-il pas une leçon de filiation pour l’Union européenne d’aujourd’hui, permettant de résister aux tentations illibérales voulant faire de l’Europe, à son tour, un empire parmi les autres, se demande-t-il ? Mais ce ne serait pas facile. Tellement la démocratie devient vulnérable face à l’empire, à l’âge des nouveaux despotes qui ont tous la même conviction que « la liberté est un luxe que le monde d’aujourd’hui ne peut plus s’offrir ».
La véritable menace, dit Dominique de Villepin, c’est que ce sont les démocraties épuisées d’aujourd’hui qui ont laissé un vide propice à la forme impériale qui les remplace silencieusement. Celle-ci émerge souvent par une distorsion lente des structures de la politique. Un premier glissement, nourrie par la fascination pour le chef, peut se faire vers une forme de monarchie élective (George Washington l’avait inscrit dans la République américaine elle-même), portée par « une attente messianique à l’égard d’un homme seul », qui guérira un désespoir politique par une espérance providentielle. En Europe aussi, et même en France, il peut y avoir cette attente d’hommes promettant de trancher, d’unifier, de décider. La deuxième distorsion est celle de l’oligarchie qui « glisse vers la ploutocratie », les gouvernements étant encerclés par une aristocratie de l’argent, comme aux Etats-Unis, avec ces milliardaires dans l’administration de Trump. En France aussi, des acteurs économiques ont une « influence considérable sur le levier médiatique », tant sur la presse quotidienne nationale que sur les audiences télévisées, et que pour les sites d’information en ligne. La méritocratie recule en France tandis que la société des héritiers progresse. La classe moyenne est celle qui ressent le plus cruellement que l’ascenseur social est bloqué. Le pouvoir se concentre, se privatise. Une troisième distorsion est plus pernicieuse, car elle concerne la démocratie elle-même, et la place donnée au peuple. Aux Etats-Unis, « toute opposition devient suspecte, toute nuance trahison ». Tandis qu’en Europe, cela s’appelle le populisme, qui est « une volonté d’épuration institutionnelle », d’abolition de « tout ce qui entrave la volonté immédiate du peuple » (les contre-pouvoirs, les médias, la justice nationale et internationale, les collectivités, l’Europe), bref une « démocratie vidée de ses garanties », réduite « à sa forme brute, instrumentalisée ». Si les réseaux sociaux jouent un rôle important, cette évolution « réside dans la mutation silencieuse du rapport des individus à la politique », c’est une « individuation extrême », où le citoyen est devenu un « consommateur politique », qui choisit, zappe, comme pour une série à regarder. Il y a une forme de laxisme civique, le langage politique perdant de sa valeur.
Dominique de Villepin nous montre ces empires qui exploitent cette « mécanique de l’épuisement démocratique », cette fatigue des peuples, et nous alerte : un peuple « lassé de sa liberté peut devenir disponible à la servitude ». Ces empires se bâtissent sur le refus de l’émancipation, des fruits de l’âge des Révolutions. Au rythme de l’épuisement du monde, ils se dressent « comme des forteresses du passé », ils sont donc réactionnaires, avec des ressorts anciens du pouvoir, la verticalité, les exclusions féroces. Ces idéologies impériales contemporaines, nous dit Dominique de Villepin, entendent toutes briser les promesses de 1789. De l’islamisme au fascisme qui a muté et ressurgit de partout, sont désignés toujours les mêmes ennemis (immigrés, étrangers, minorités) pour imposer la domination. Quant au néolibéralisme, il s’est durci en guerre sociale, fracturant les sociétés, creusant les écarts. Tous ces empires sont la mort de la politique. Ils se posent en civilisations, en Etats-civilisations, qui « s’enracinent dans des récits anciens, des mémoires blessées, des nostalgies impériales ». (Rôle croissant de l’évangélisme ultraconservateur dans la vie politique américaine, récupérant la ferveur d’un peuple en quête de repères, la foi étant un « levier d’emprise et de pouvoir », retour idéologique du communisme chinois). Ce qui vacille, « ce ne sont pas seulement les institutions, mais une philosophie du monde, née avec la Révolution française, prolongée par les grands basculements du XXe siècle » écrit Dominique de Villepin. On a eu tort de croire que l’onde révolutionnaire avait pris fin en 1989 avec la chute du mur de Berlin, et que la démocratie libérale était le point final et le terme naturel de toute évolution. Voici venue, dit-il, « l’heure d’un nouveau combat contre l’hypercratie, cette forme liquide et tentaculaire du pouvoir globalisé, médiatique, algorithmique, déresponsabilisé ». Ce combat est décisif, de lui dépend la possibilité même de la politique. Qui doit réaffirmer « les principes fragiles… de l’héritage révolutionnaire », pour retrouver « la force d’un idéal partagé », celui « d’un monde où l’homme, libéré des dominations, retrouve le pouvoir de dire ‘nous’, ‘le pouvoir de dire nous, le peuple’ ».
Ayant peint l’impérialisme qui s’enracine à l’intérieur, Dominique de Villepin dessine alors celui qui se déploie à l’extérieur, avec un monde qui ne se structure plus selon l’ordre westphalien des Etats-nations, mais selon des logiques impériales, nous faisant entrer dans un nouvel âge de fer, où c’est la lutte pour l’accès aux ressources devenues rares, pour se prémunir de la pénurie. Les Etats-Unis ont amorcé avec Obama ce virage impérial par une logique de réseaux, d’infrastructures, de contrôle périphérique, depuis un pivot asiatique, l’Europe n’étant plus au centre de la stratégie américaine. Un Yalta avec la Chine, avec un partage des zones d’influence, est redouté mais peut se produire, celle-ci voulant une « sécurisation offensive des ressources », d’où les Nouvelles Routes de la Soie. La logique de cette Chine n’étant pas seulement économique mais sociale et politique, le Parti Communiste chinois s’adressant désormais aux classes moyennes des grandes villes. La stratégie chinoise, longue et patiente, est celle de laisser l’Amérique s’isoler, et alors l’hégémonie s’imposera d’elle-même. Quant à la Russie post-soviétique, elle n’a jamais quitté l’empire. Sa logique de reconquête de sa zone d’influence, d’encerclement souple, d’expansion périphérique, exploite ce que la guerre en Ukraine a confirmé au reste du monde : à savoir que « les règles internationales n’étaient plus universelles », et que l’usage de la force devenait possible.
Ce nouvel âge de fer disloque le monde d’après 1945, fait s’emballer l’histoire et s’éloigner l’idéal d’un monde organisé autour d’Etats libres, égaux, coopérants. La guerre devient toujours latente. Ses lignes de front sont les routes maritimes, où tout est surveillé. La guerre de demain, dit Dominique de Villepin, se fera dans les ports du Golfe, sur les rails des routes de la Soie, dans les batteries électriques ou les réseaux de fibres sous-marines. Cette guerre non déclarée est omniprésente, dans l’espace aérien, maritime, les empires se réarment, modernisent leurs arsenaux nucléaires, fabriquent des drones, créent des cyberarmes, des intelligences artificielles militaires. La prolifération nucléaire tire les leçons de l’attaque de l’Ukraine par les Russes. Ceux-ci ne l’auraient pas envahie si Kiev, en 1994, « n’avait pas cédé son arsenal nucléaire en échange de la garantie des frontières par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ». Cette guerre est désormais hybride, poursuit Dominique de Villepin. Car elle brouille, dit-il, « les frontières entre guerre et paix, entre civil et militaire » et surtout « dissout les distinctions fondatrices du droit international et de la démocratie ». C’est une guerre perpétuelle qui est un outil de maintien de l’ordre par la peur, et un instrument d’expansion dans le monde. Elle mobilise « tous les leviers de la puissance » : militaires, économiques, technologiques, culturels, cognitifs. Les sociétés étant les premières cibles.
Il ne s’agit pas, nous dit Dominique de Villepin, d’une Troisième Guerre mondiale, « mais une guerre totale d’un type inédit : déterritorialisée, multidimensionnelle, sans déclaration de guerre ni paix possible ». Ce nouvel âge de fer est déjà là. Ce qui se joue en Ukraine, à Gaza, dépasse l’Ukraine et Gaza, car la guerre est devenue « une méthode banalisée du rapport de force ». L’Europe ne doit pas tomber dans ce piège qui se referme. Car aussi bien à Moscou qu’à Washington, le but c’est de « faire de l’Europe le marchepied de leur stratégie », une Europe divisée, exposée, serait alors mise devant le fait accompli. Elle doit tenir, en commençant par un soutien vital à l’Ukraine. Faces à ces crises, trois principes, écrit Dominique de Villepin, doivent guider l’action européenne, car il n’y a pas de plus grande force que ces principes face au cynisme des empires : le principe d’unité des Nations ; le principe de sécurité par une dissuasion se construisant lentement, ayant une vue d’ensemble, et dans une stratégie partagée ; le principe de l’indépendance, notre force, rappelle Dominique de Villepin, résidant dans notre fidélité à notre tradition diplomatique, à la parole tenue, à la recherche des équilibres, à la paix qui se bâtit. Ce sont la France et l’Europe qui doivent être les architectes politiques d’une paix en Ukraine fondée sur le droit, la souveraineté des nations, la sécurité collective. Idem à Gaza, où « les peuples sont traités comme des variables secondaires » et où l’Europe doit réussir à se faire entendre. Et aussi que les pays de la région se mobilisent, et le « Plan adopté au Caire constitue aujourd’hui une alternative crédible » face au Plan Trump et sa « Riviera on Gaza » qui rappelle les réserves indiennes où jadis les Etats-Unis avaient déplacé les Indiens. Quant à l’Europe de l’Est, elle redevient ce qu’elle fut si souvent, cet « espace de frictions, d’affrontements et de glacis ». L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 ayant créé le fait accompli – permettant sa répétition ailleurs - de la remise en question de l’intangibilité des frontières, du traité de Budapest de 1994 garantissant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, teste la détermination européenne. Et celle-ci doit prouver à Poutine que dans son jeu, s’est glissée la résistance d’une Europe s’engageant durablement sur les fronts vitaux de la défense du droit international et de la garantie de sa sécurité sur sa frontière orientale. Quant au Moyen-Orient, « traversé par des conflits identitaires, religieux, énergétiques », ce n’est pas seulement le théâtre des affrontements entre grandes puissances mais le « creuset où s’imbriquent toutes les logiques impériales » (à l’extérieur, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, et à l’intérieur de cette région, l’Iran, Israël, Turquie, Arabie Saoudite), comme dans le carrefour du monde. Mais, dit Dominique de Villepin, « nul ne peut durablement imposer son hégémonie ». Puis il rappelle qu’avec la tragédie du 7 octobre 2023, une nouvelle ère s’est ouverte pour les peuples de la région en même temps que les plaies non cicatrisées du passé. Cette attaque terroriste d’une ampleur inédite, et la réponse d’Israël dans une logique de guerre totale, sur sept fronts, conduisent au double risque de « voir basculer la démocratie israélienne vers un modèle séparatiste, annexionniste, militariste » et de « laisser dans l’histoire collective, les stigmates durables de bombardements massifs sur Gaza et du siège imposé à une population entière en violation du droit humanitaire international ». Et seule la « justice pour tous les peuples de la région, y compris les Palestiniens, mais aussi les Libanais et les Syriens » peut conduire à une paix durable, et à un ordre véritable au Proche-Orient. L’Amérique latine, où les ressources sont abondantes et attisent les convoitises et les rivalités, est redevenue « un espace d’intérêt stratégique mondial », elle n’est plus seulement l’arrière-cour des Etats-Unis, la Chine et la Russie y avancent leurs pions. Il n’y a que le Brésil, avec Lula, qui tente de construire une troisième voie, une autonomie stratégique, que l’Europe doit soutenir, notamment en considérant le traité Union-Mercosur selon une dimension géopolitique et pas seulement économique. L’Asie du Sud-Est est la zone pivot du XXe siècle, le cœur battant de la mondialisation, le théâtre pacifique de l’affrontement sino-américain, où les Etats devront veiller à leur indépendance. Quant à l’Afrique, elle reste l’objet des convoitises multiples, mais les tentatives d’hégémonie échouent, alors même qu’un empire africain ne se dessine jamais. La course impériale des convoitises exploite l’instabilité chronique, les tragédies humaines. L’Europe, écrit Dominique de Villepin, a la responsabilité morale d’empêcher un nouveau partage de l’Afrique, en entrant dans la bataille collective pour la croissance et le développement en appelant les donateurs mondiaux à s’impliquer dans une nouvelle stratégie collective, alors même que Trump a brutalement retiré la part américaine versée à l’USAID. En conclusion, Dominique de Villepin dit que cette guerre hybride, au-delà de ses batailles géographiques, prépare la bataille contre l’ordre international conçu en 1945, cette paix par le droit, cette souveraineté par l’égalité, cette sécurité collective par l’alliance. Les empires soit n’en veulent plus, soit veulent le remodeler à leur avantage. Elle n’a pour tout horizon que l’hégémonie, la domination exclusive. A cela doit s’opposer L’EUROPE – seul antidote permettant encore d’espérer un monde sûr - comme puissance régulatrice, et la REPUBLIQUE comme principe de souveraineté.
Cette EUROPE a été réveillée brutalement par la guerre en Ukraine, qui lui a fait prendre conscience de ses dépendances énergétiques, de ses insuffisances militaires. La défense européenne doit se doter d’une défense militaire, d’une « armée commune aux Européens ». Les membres européens de l’OTAN œuvrant à un OTAN à deux vitesses, dans la création d’une avant-garde européenne, et en tissant des partenariats avec le Royaume Uni, la Turquie, la Norvège. L’équipement militaire doit prendre de l’indépendance par rapport au matériel américain par des installations industrielles de défense en Europe, un emprunt européen mutualisant les achats. La force militaire européenne doit conserver une crédibilité globale, notamment par un deuxième porte-avion, et une extension du stock d’armes nucléaires. Il faut aussi un effort éducatif pour ajouter une dimension de défense civile, des compétences par exemple en cybersécurité étant vitales, d’où le besoin d’ingénieurs.
Cette Europe réveillée doit se construire en puissance d’équilibre, et par conséquent proposer « un modèle alternatif aux impérialismes agressifs », en défendant le droit international et les institutions multilatérales. La diplomatie climatique, en regard justement de cet épuisement de la Terre, prend un « enjeu identitaire et structurant », construisant des passerelles entre le Nord et le Sud. Si elle ne réussit pas à entraîner le sursaut vital, ce sera son effondrement définitif, dit Dominique de Villepin. L’Europe doit réussir à rester une puissance bienveillante et post-impériale, existant par l’exemplarité et non par la force, défendant envers et contre tout l’ordre juridique international, capable d’accueillir ceux qui le souhaitent, et en réformant les grandes institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiales, l’ONU, afin « d’acter une géopolitique du développement plus juste ». L’Agence internationale « à l’énergie atomique doit à nouveau être le fer de lance d’une politique de non-prolifération » multilatérale et crédible. Le visage militaire de l’IA doit aussi être supervisé. Et un nouveau traité de l’espace « doit rappeler et rendre applicables les principes de non-militarisation et de non-appropriation de l’espace exo-atmosphérique ». La Banque mondiale doit s’élargir « à la supervision des échanges mondiaux liés aux matières premières stratégiques », notamment le cuivre et le nickel. L’ambition, dit Dominique de Villepin, n’est pas de dominer, mais de relier, non pas d’incarner mais de faire vivre la promesse. Sa conviction est que l’Europe peut vraiment offrir une alternative d’équilibre, et qu’il existe donc « une autre voie que celle du fer et du sang pour maintenir l’unité, la prospérité et la sécurité ». Cela ne peut se faire qu’à l’échelle continentale, et en assumant « la vocation internationale et ouverte de ce camp du juste équilibre ». Et en tissant des liens, dans ce monde fracturé. Cet espoir de résister ne peut réussir qu’en s’appuyant « sur les braises encore vives de la démocratie », que ce soit « l’espoir populaire en Inde », « l’envie de liberté en Chine », « la soif de développement en Afrique », « la peur persistante du fascisme oligarchique qui guette aux Etats-Unis ». Il faut tendre la main à ces forces qui sont bien réelles, partout. Tout ce qu’un Etat européen ne pourra pas faire tout seul, un saut confédéral européen renouvelant la libre association des Etats pourra alors le faire. Ceci nécessitant de prendre le temps d’une convergence économique, politique, sociale, pour éviter les blocages des décisions. De prendre le temps d’une consolidation sociale, l’Europe étant une communauté de vie qui a construit « une protection sans équivalent dans le monde des droits individuels, environnementaux et sociaux », progrès qu’il s’agit de poursuivre pour que le modèle rayonne sur la planète, en développant la compétitivité économique et la croissance, l’innovation technologique, le développement d’instruments de financement mobilisant l’épargne des Européens au profit de l’économie européenne. De consolider politiquement la démocratie, avec sa justice indépendante, sa presse libre, son respect des minorités. La démocratie étant la condition pour entrer dans l’Union européenne.
Cette REPUBLIQUE doit se redresser. L’État-nation est tiraillé entre l’abandon et la fidélité à ses principes, et entre deux camps. Celui, réactionnaire, de la Contre-Révolution, qui veut abolir l’héritage des Lumières, instrumentalise la peur, rejette la liberté au nom d’une identité figée, refuse la diversité, parle aux instincts, promet un ordre fondé sur la domination. Et celui des enfants de la Révolution, divisé entre ceux qui veulent prolonger l’élan révolutionnaire et ceux qui veulent consolider les acquis. Ce camp devrait être au contraire celui de la sagesse, aspirant à une modernité qui est consciente de ses limites, et surtout attentive à l’épuisement des ressources, à la vulnérabilité des sociétés, à la fragilité des individus, qui a pour but de bâtir un humanisme écologique, une économie des communs, et vise à la naissance d’une République des vivants. Il s’agit d’enraciner la souveraineté dans le réel, dans le comment vivre ensemble, non plus de conquérir le monde. De refonder une République des Lumières assumant les limites de la puissance humaine, capable de dire NON à l’exploitation sans fin, à la marchandisation de l’intime, à une technologie sans éthique. Et de dire OUI à la transmission, à la diversité, à la lenteur et à la beauté du monde, à la poésie.
Alors, il faut, écrit Dominique de Villepin, réarmer la démocratie non pas par la force mais par la confiance retrouvée, par la réhabilitation des corps intermédiaires, en redonnant du sens au suffrage, en renforçant les solidarités concrètes. « L’État-nation s’est voulu moderne ; il est devenu managérial » (Macron), et la « verticalité du pouvoir a trahi la promesse horizontale du candidat », dit-il. Le « pouvoir s’est éloigné des classes populaires, s’est confondu avec les intérêts des classes moyennes supérieures », d’où le ressentiment social (Gilets jaunes, colère de la jeunesse, révoltes des banlieues). Mais le plus grave, dit-il, est la transformation de l’idée de nation, qui n’est plus républicaine, fondée sur la volonté commune. L’identitarisme l’a appauvrie, l’a fermée sur elle-même, désignant selon les réflexes de la Contre-Révolution l’ennemi à traquer. « On ne cherche plus à comprendre » mais on désigne, à chaque crise, son bouc émissaire. Il faut rajeunir la République, redonner à la démocratie la capacité d’agir pour renouer avec l’ordre et la justice.
Un ordre qui n’est pas autoritarisme, mais respect des règles, efficacité des institutions, légitimité retrouvée de l’action publique. Un Etat qui connaît son territoire. Une justice respectée, qui reconnaît le mérite, l’effort, la réalité sociale de chacun. La République doit être « une promesse politique incarnée, adaptée à chacun ». Revenir aux fondamentaux. Retrouver le temps long de la délibération démocratique. Une humilité qui rajeunit la République. Transformer le réel par la parole partagée. Trois souverainetés héritées de l’âge des révolutions, écrit Dominique de Villepin, forme le trépied qu’il s’agit de restaurer. La souveraineté nationale qui s’exprime par la parole des pays dans le monde, cette voix que la France a beaucoup perdue, et la diplomatie climatique peut faire beaucoup pour qu’elle redevienne grande dans le monde comme une puissance d’équilibre, et sa diplomatie collective permettant de retrouver dans le monde des points d’appui durables, ainsi que sa diplomatie d’initiatives en direction de la solidarité entre peuples, et une diplomatie pacifique. La souveraineté nationale exprime notre liberté dans le monde par une politique culturelle ambitieuse, généreuse et populaire. Car la France, c’est le facteur humain, dit Dominique de Villepin. La souveraineté populaire, qui ne peut pas se contenter d’un vote tous les cinq ans, mais exigeant des contre-pouvoirs effectifs, une information pluraliste, des droits garantis, et que le citoyen ne soit pas réduit à un consommateur d’opinion, mais « comme un sujet de droits et de devoirs ». La « souveraineté individuelle est le fondement moral de tout l’édifice », n’a rien à voir avec l’individualisme, mais « est le droit de chacun à être reconnu dans sa dignité, de disposer de soi, et de prendre part à la vie commune ». Sa vie doit être digne, recevoir l’éducation, avoir droit à la santé, l’emploi, la culture. A l’heure de l’épuisement du vivant, du dérèglement climatique, de l’effondrement des équilibres planétaires, cette liberté individuelle est vitale afin que tout ne tourne pas à la domination. La souveraineté de la personne, rappelle Dominique de Villepin, s’enracine dans l’autonomie des Lumières, celle de l’individu capable de raison, de jugement, de discernement, s’épanouissant dans une culture humaniste, plaçant la dignité humaine au sommet de l’édifice républicain. Cette souveraineté doit être renouvelée, à l’ères de l’IA, en inventant « une nouvelle génération de droits : les droits cognitifs », qui protègent non seulement nos corps et nos biens, mais aussi « notre esprit, notre capacité de juger, notre libre-arbitre », et redéfinissant donc le statut de nos données personnelles. Dominique de Villepin propose que l’Europe pose « les bases d’une nouvelle souveraineté numérique, reconnaissant à tous les citoyens le droit à ne pas être assigné à une bulle numérique, mais aussi un véritable droit à l’oubli ». Cela suppose de repenser la propriété intellectuelle. Non seulement la liberté de penser est menacée par la censure directe, mais aussi par le brouillage permanent. Surtout, il faut une éducation qui apprenne à penser par soi-même, ce qui est indispensable pour la souveraineté individuelle. La liberté d’expression doit être respectée, mais aussi encadrée, notamment sur les réseaux sociaux, où règne la désinformation qui détruit le débat démocratique. La dignité de la personne est aussi bien sûr matérielle, et exige que chacun ait accès à un minimum vital, un logement digne, un emploi stable, une santé protégée. Une société juste est celle où personne n’est inutile, où est tenue la promesse « que chacun puisse se tenir debout, sans renier ce qu’il est ». Le nouvel acte républicain doit donc être refondateur, répondant à cette crise de la modernité par une fidélité active à son idéal, qui est d’émanciper l’humanité, en assumant ses limites.
Nous traversons, dit-il, un changement d’ère. « La planète s’épuise, les sociétés se crispent, les démocraties doutent d’elles-mêmes ». C’est l’impasse d’un modèle de civilisation fondé sur l’illimité, sur la conquête de la nature, sur la croissance perpétuelle et une confiance aveugle dans la technique », et le « signes sont là, massifs, incontestables : dérèglements climatiques, effondrement du vivant, retour des conflits armés, montée des régimes autoritaires, fatigue démocratique, sentiment diffus de dépossession, d’impuissance, de solitude ». Il s’agit de ne pas être complices, mais de retrouver le cap, de reprendre l’initiative, d’inventer autre chose, un équilibre nouveau, une force nouvelle. « Une fidélité à ce que nous avons été, et un courage tranquille pour ce que nous devons devenir ».
Alors, au recommencement, écrit Dominique de Villepin, il y a la reconnaissance de nos limites, de notre finitude. Et cela « exige une révision de notre rapport à la Terre ». Devant cette planète pillée et polluée, qui se révolte par ses changements climatiques, qui semble avoir enclenché une procédure d’apoptose, l’exigence écologique est le socle de principes sur lequel reconstruire durablement, et il propose d’inscrire dans la Constitution la neutralité carbone pour 2050. Et reconnaître également sur le plan juridique les écosystèmes, la protection du cycle de l’eau, les sols fertiles, les forêts primaires, la fin de l’exploitation aveugle des ressources. Il s’agit de planifier, non pas s’en tenir à l’interdiction. Et d’augmenter les espaces sanctuaires permettant la renaissance de la biodiversité.
Dans cet essai, Dominique de Villepin nous force à la prise de conscience. Et à l’urgence de dire Non au choix à reculons, suicidaire, des nouveaux empires réactionnaires. Pour dire oui au rétablissement de la souveraineté populaire, puisque chaque humain accueilli sur cette Terre à tirer du désastre veut vivre, et seule la République des vivants à construire peut lui offrir une nouvelle aube tenant ses promesses là où les progrès, faisant croire à l’inépuisable, à la maîtrise des humains sur la nature, ne les ont pas tenues. Il faut redonner du poids à la parole citoyenne. Le Parlement « doit redevenir le cœur battant du débat public démocratique. Le gouvernement ne peut plus gouverner seul… Il doit accepter l’épreuve du dialogue… Les citoyens doivent pouvoir intervenir… Les collectivités territoriales doivent être libérées de leur tutelle implicite… Dans chaque quartier, dans chaque village, il faut faire renaître le sentiment d’une citoyenneté concrète, visible, active… les contre-pouvoirs doivent être protégés ».
Dominique de Villepin propose non pas un idéal hors de portée mais « un horizon de responsabilité », une capacité de « faire œuvre commune ». Alors, « il faut également avoir le courage de dire oui à ce qui nous unit et nous élève », à cette « République restaurée, où la liberté est retrouvée, l’égalité assurée et la fraternité éprouvée, un oui « à une démocratie rajeunie… à un monde plus respirable, plus humain, plus juste, où la barbarie recule et les Lumières progressent ». Les Français et les Européens étant têtes de proue parce qu’ils ont la mémoire d’un XXe siècle de « déchirures, des empires, des dominations, des barbaries inouïes » et en ont tiré des leçons, qui ont fait naître une idée du droit, de la paix, de la coopération, pour bâtir cet espace commun de l’Europe « où la force ne fait pas la loi, où l’arbitraire n’est pas la justice ». C’est cet héritage, dit Dominique de Villepin, qu’il s’agit de faire vivre aujourd’hui, qui est porté à la fois par l’exigence des générations du futur et par l’exemple des générations qui nous ont précédés.
Alice Granger
Livres du même auteur
et autres lectures...
Copyright e-litterature.net
toute reproduction ne peut se faire sans l'autorisation de l'auteur de la Note ET lien avec Exigence: Littérature